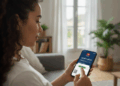L’arrêt commenté de la cour d’appel de Tunis illustre les difficultés à maîtriser les techniques du droit des sociétés et du droit comptable. Par deux actes sous seing privés datés du 14 mars 2012, un associé dans une société à responsabilité limitée a cédé la totalité de ses parts sociales à deux autres associés. Trois années plus tard, il agit devant le tribunal de première instance de Ben Arous requérant la condamnation de la société émettrice des parts cédées au paiement de 130.811,378 dinars et de 35.652,472 dinars représentant respectivement sa part dans les bénéfices des exercices 2010 et 2011. Il demande également le remboursement de ses avances en compte courant d’associés mais cet aspect du conflit ne retiendra pas notre attention. Les faits, établis par l’arrêt, révèlent que la société a tenu, dans les délais légaux, ses assemblées générales annuelles au titre des exercices concernés. Les états financiers de 2010, approuvés, font ressortir un résultat bénéficiaire. Il est affecté en totalité au report à nouveau. Les états financiers de 2011 ont enregistré une perte que l’assemblée générale a imputée sur le report à un nouveau bénéficiaire tout en décidant une répartition partielle de dividendes à prélever sur le report antérieur ; bien évidemment le reliquat est reporté à l’exercice prochain. Toujours est-il que la cession a eu lieu postérieurement à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice 2011 et l’associé cédant a perçu de la société sa part dans les dividendes mis en distribution.
Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la juridiction de premier degré rejette le premier chef de la demande au motif que « le demandeur a approuvé les états financiers de l’exercice 2010 sans distribution de bénéfices dans un premier temps et il a obtenu sa part dans les bénéfices reportés s’élevant à la somme de 158 mille dinars dans un deuxième temps ». Elle en tire cette conséquence que « la société a mis en distribution les bénéfices de l’exercice 2010 et qu’il n’y a pas lieu de les réclamer une autre fois ». Néanmoins, le tribunal condamne la société au paiement du montant demandé au titre de l’exercice 2011 « considéré comme la part des bénéfices revenant au demandeur non distribué à la date de la cession des parts sociales ».
Les parties ont interjeté appel devant la cour d’appel de Tunis laquelle a rendu un jugement confirmatif de principe tout en augmentant le montant de la condamnation au titre de 2011 à la somme de 107.841,534 dinars.
La cour d’appel a motivé sa décision dans les termes suivants :
« La cession par un associé de ses parts dans le capital social n’empêche pas qu’il puisse agir pour réclamer les droits attachés auxdites parts pour la période antérieure à la date de la cession ».
« Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, le résultat reporté (les bénéfices reportés) ne devient pas une partie des capitaux propres de la société dans la mesure où l’assemblée générale n’a pas décidé son incorporation au capital ; il demeure donc un droit des associés ; ils peuvent en demander la distribution en totalité ou en partie ».
Et la cour d’appel d’ajouter que :
« La dernière assemblée générale ordinaire, précédent la cession, à laquelle a assisté l’appelant, a décidé de distribuer la somme de 476.565,000 dinars sur un montant de 873.387,000 dinars ; qu’en application de l’article 140 du code des sociétés commerciales, elle a décidé le maintien du reliquat en tant que bénéfice de sorte qu’il ne peut être considéré comme faisant partie des capitaux propres de la société dans la mesure où il n’est pas incorporé au capital ».
La cour d’appel continue de motiver sa décision en notant que :
« Contrairement à ce qui est soutenu, nulle clause dans l’acte de cession ne signifie que les parties se sont mises d’accord à ce que les droits résultant des parts sociales se rapportant à la période antérieure à la cession soit transmis au nouveau propriétaire et la privation du vendeur ‘’des fruits et accroissement de la chose, tant civils que naturels’’ avant la vente appartiennent à vendeur s’il n’y a convention contraire’’ (art 609 du COC) ; de surcroît rien dans les deux contrats ne signifie que l’accord s’est établi que le prix de vente soit fait sur la base de la valeur mathématique ou la valeur vénale des parts sociales pour justifier de retrancher le surplus de la valeur nominale de la part du vendeur dans les bénéfices résultant des parts sociales avant la cession ».
Enfin, la cour d’appel se réfère à l’arrêt des chambres réunies n°78192 du 28 mai 2015, dont elle cite le principal attendu selon lequel : « Chaque associé est en droit de réclamer sa part dans les bénéfices au cas où ils existent si la société ne les lui attribue pas ; quand bien même la délivrance de la chose vendue comprend ses accessoires, comme il est énoncé à l’article 610 du COC, la cession des actions n’entraîne transfert des bénéfices qu’à compter de la date de la vente et par conséquent les fruits demeurent acquis au vendeur qui a qualité de propriétaire à cette date ».
Appréciation. Il est acquis que les juges tranchent les litiges en application de la règle de droit. Celle-ci est définie comme étant une norme générale, impersonnelle, permanente en vigueur dans le système juridique. En outre, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il est fait interdiction aux juges de prononcer des arrêts de règlement, c’est-à-dire des jugements ayant une valeur normative pour le futur. Il découle de ces deux principes, (obligation de motivation en droit et interdiction des jugements de règlement) que le juge ne peut motiver son jugement par un précédent. Il n’est pas possible de présenter un pourvoi en cassation pour violation d’une jurisprudence établie et un jugement fondé sur une jurisprudence établie ou sur un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation est irrégulier et mérite la censure pour ce seul motif. La cour d’appel qui, dans notre cas, a cru pouvoir motiver sa décision par référence à un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation a enfreint sûrement à l’obligation de motiver sa décision en droit et son jugement mérite cassation pour cette considération.
Abstraction faite de ce vice de motivation, la solution donnée par l’arrêt de la cour d’appel est, à notre sens, doublement mal-fondée. Elle aurait dû déclarer l’action irrecevable faute d’intérêt pour agir (§1) et aurait dû s’abstenir de s’immiscer dans la gestion financière de la société (§2).
- 1 L’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt
La cour d’appel a jugé que « la cession par un associé de ses parts dans le capital social n’empêche pas qu’il puisse agir pour réclamer les droits attachés auxdites parts pour la période antérieure à la date de la cession ». C’est une réponse à une exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse. Le demandeur a cédé ses parts et ne justifie pas de qualité pour agir. Il fallait peut-être viser le défaut d’intérêt mais puisque toute personne ayant intérêt à agir a nécessairement qualité. La distinction des deux concepts ne pose un intérêt pratique que si l’action est attitrée n’est ouverte qu’à des personnes désignées par la loi même si d’autres personnes y ont intérêt. Toujours est-il que le défaut d’intérêt ou le défaut de qualité touche à l’ordre public et le juge le soulève d’office.
Il faut bien rappeler l’objet de l’action. Elle ne tend pas au paiement par la société des dividendes que l’assemblée générale a décidé de distribuer, mais plutôt au paiement d’un supplément de dividende à prélever sur les bénéfices qu’elle a réalisés et dont il a été décidé de reporter à nouveau. Cette différence entre une action en paiement d’un dividende distribué et une action en supplément de distribution rejaillit sur l’intérêt à agir.
Si le demandeur poursuit le paiement des dividendes dont la distribution est décidée par l’assemblée générale, son action sera certainement recevable, car l’associé agissait, dans ce cas, comme créancier de la société. Son droit de créance n’est pas éteint par la cession des parts sociales. La créance des dividendes est entrée dans son patrimoine à la date de la décision de l’assemblée générale même si le paiement est assorti d’un terme. C’est pour cette raison que la créance peut être saisie-arrêtée par les créanciers personnels de l’associé.
En revanche, quand le demandeur agit pour demander au juge de décider un supplément de répartition des bénéfices à prélever sur les bénéfices reportés, il se comporte non comme un créancier mais comme membre d’une société. Il n’a aucune créance, mais voudrait bien en avoir. Ses créanciers personnels ne pouvaient rien saisir-arrêter des bénéfices sociaux reportés tant qu’aucune nouvelle répartition n’est pas décidée. Les bénéfices reportés sont la propriété de la société.
En droit, l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt. La règle est formulée à l’article 19 du code de procédure civile et commerciale. L’intérêt pour agir doit exister au moment de l’action. Techniquement, on exprime cette règle en disant que l’intérêt doit être actuel, c’est-à-dire contemporain à l’action. L’explication que l’on donne à cette exigence est que juge est appelé à trancher des litiges déjà nés. Dans cette perspective, l’intérêt pour agir ne peut pas être prématuré ou dépassé. Pour apprécier le bien ou mal-fondé de la décision de la cour d’appel sur ce point de droit, nous allons envisager plusieurs éventualités selon que le demandeur est encore associé au moment de l’action (a) ou a perdu cette qualité avant d’engager l’action (b) ou pendant l’instance (c).
- Le demandeur est un associé au moment de l’action
Nous raisonnons ici par contraste aux faits de la cause. Nous supposons un instant que le demandeur n’a pas cédé ses parts sociales et qu’il continue à avoir la qualité d’associé. Dans quel contexte peut-il agir contre la société pour obtenir la même satisfaction ?
On suppose pour les besoins de l’analyse que l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur l’exercice 2011 a constaté que les états financiers font ressortir un bénéfice distribuable d’un montant de 873.387,000 dinars après déduction de la perte de l’exercice.
Nous posons comme hypothèse que le gérant, auteur de la convocation à l’assemblée générale, soumet aux voix des associés présents un projet de résolution portant la distribution d’un dividende d’un montant de 476.565,000 dinars.
On suppose, pour faire simple, que l’un des associés, vote contre la résolution, car il estime que le montant proposé est insuffisant, mais sa position d’associé minoritaire ne lui permet pas d’agir sur la volonté collective des associés. Le projet de résolution passe donc à la majorité des voix. Mécontent, notre associé décide d’agir contre la société.
On peut penser que notre associé souhaite faire un raccourci. Au lieu d’agir en nullité de la délibération relative à l’affectation des bénéfices distribuables, il demande au juge de se substituer ni plus ni moins à l’organe compétent, l’assemblée générale, et décider lui-même l’affectation en tout ou en partie en dividende. Il a intérêt personnel et actuel pour agir en paiement de ce qui semble lui revenir selon sa prétention. Peu importe pour nous la solution au fond.
Le demandeur peut encore agir contre la société pour demander la nullité de la délibération de l’assemblée générale relative à l’affectation des bénéfices. Là également, il a un intérêt personnel et actuel pour agir. Une fois la nullité de la délibération prononcée, l’assemblée générale délibérera une nouvelle fois sur l’affectation du bénéfice distribuable. L’action qu’intenterait notre associé mécontent serait en définitive une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité. L’associé a intérêt actuel (et qualité) pour agir quand bien même il ne détiendrait qu’une seule part sociale. C’est que contrairement à ce qui est prévu à l’article 290 du code des sociétés commerciales pour les sociétés anonymes, un associé détenant une seule part sociale peut agir en nullité pour abus de majorité. L’action d’un actionnaire dans une société anonyme, n’est recevable que s’il justifie la détention d’un pourcentage minimum d’actions dans le capital social, à savoir 10%. En d’autres termes, l’action en nullité d’une délibération prise par une assemblée générale d’une SARL n’est ouverte qu’à la personne ayant la qualité d’associé au moment de l’action, peu importe la quantité de titres détenus. En revanche, dans une société anonyme, il faut être un actionnaire qualifié détenant un certain pourcentage de titres calculé par rapport au capital. C’est donc une action attirée. Un actionnaire détenant une fraction moindre que celle exigée par la loi a certes un intérêt actuel pour agir mais n’a pas de qualité pour le faire.
D’une manière générale, la qualité d’associé à un moment donné permet d’exercer, dans les rapports avec la société, les prérogatives de nature politique (droit de vote, droit de poser des questions, droit d’accès aux documents,…) et pécuniaire attachées à ce statut. Chaque prérogative est protégée par une action en justice. Ainsi par exemple, l’associé peut contester la validité d’une assemblée générale ou exercer une action ut singuli contre le gérant fautif, requérir une expertise de gestion. Mais pour ces deux derniers exemples, le code des sociétés commerciales ne se contente pas de la qualité d’associé, il exige que le demandeur détienne une certaine fraction de capital social. Un associé ne détenant pas la fraction de capital requise a certes intérêt actuel à agir mais pas la qualité. L’action ut singuli et l’expertise de gestion sont dites des actions attitrées qui ne peuvent être exercées que par les associés qualifiés.
- Le demandeur n’est plus associé au moment de l’action
En procédure civile, on exige que l’intérêt pour agir soit actuel, c’est-à-dire avéré au moment où l’action est engagée. « La demande n’est pas recevable en considération d’un intérêt passé ».
Une personne peut perdre la qualité d’associé. Les techniques juridiques qui conduisent à un tel résultat sont diverses.
La perte de la qualité d’associé peut résulter d’un départ volontaire où une personne cède tous ses titres de participation comme elle peut résulter d’un départ obligé où l’associé se voit infliger une décision d’exclusion dans les cas où cela est permis. Le départ de l’associé peut aussi être la conséquence d’une réduction du capital à zéro pour absorber les pertes et une augmentation de capital à laquelle il ne souscrit pas.
En cédant ses parts sociales, l’associé sortant reçoit un prix payé par le vendeur. Le prix est librement négocié entre les parties et la société, considérée comme un tiers, ne peut se voir imposer des obligations. La cession lui est simplement opposable à partir de sa signification à elle. Désormais, à partir de cette date, le nouvel associé est le cessionnaire ; en cas d’exclusion de la société, l’associé exclu aura droit au remboursement de la part qu’il a dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l’exclusion a été prononcée. Il ne participe aux bénéfices et aux pertes postérieures à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s’est fait avant l’exclusion. Il ne peut exiger le paiement de sa part qu’à l’époque de la répartition d’après le contrat social (art. 1327 du code des obligations et des contrats). La perte de la qualité d’associé par voie de cession est instantanée alors que si elle résulte d’une décision d’exclusion ou d’une réduction de capital à zéro non suivie de souscription, s’inscrit dans la durée.
Quand un associé perd la qualité d’associé peut-il avoir intérêt actuel d’exercer des prérogatives d’associés ? La réponse est certainement négative. La situation de l’ancien associé devient similaire à celle d’un tiers étranger à la société. On fera comme s’il n’a jamais été associé. Pour nous en convaincre, nous raisonnons à partir de l’hypothèse où l’ancien associé souhaite redevenir associé en se portant acquéreur de certaines parts sociales. Ce serait dans une telle éventualité, une cession à un tiers étranger où il faudrait suivre le formalisme de cession des parts sociales prévu à l’article 109 du code des sociétés commerciales. Une cession faite en violation de cette disposition est nulle dans les rapports entre les parties et ne peut être opposée à la société. La qualité d’ancien associé ne dispense pas du formalisme légal. Autre exemple : un ancien associé ne peut également exercer l’action ut singuli contre le gérant même si la faute de gestion et le préjudice qui en résulte pour la société sont survenus antérieurement à la cession. En d’autres termes, la cession des parts sociales que l’associé a consentie exprime son intérêt négatif à la société. Cet associé a préféré voter par les pieds au lieu de voter par la main : il quitte la société en cédant ses parts sociales et le prix de cession qu’il a convenu avec le cessionnaire exprime son seul intérêt économique. L’ancien associé n’a donc aucun intérêt actuel pour agir en responsabilité. Mais il n’est pas interdit que le cessionnaire exerce lui-même l’action. C’est qu’en se portant acquéreur des parts sociales, il acquiert tous les droits et obligations inhérents aux titres. S’il décide d’agir, le juge déclarera l’action recevable car elle émane d’une personne qui a un intérêt actuel.
La qualité d’associé du demandeur disparaît en cours d’instance
Il arrive que la perte de la qualité d’associé survienne en cours d’instance. Au moment de l’action, le demandeur avait qualité d’associé mais il cède en cours d’instance ses parts sociales. Quel impact peut avoir la perte de la qualité d’associé sur la poursuite de l’affaire ?
La jurisprudence française a eu l’occasion de se prononcer en faveur de la poursuite de l’action dans un tel cas. « Une situation passée peut laisser subsister un intérêt actuel ». Il a été jugé que l’intérêt d’obtenir l’annulation d’une assemblée générale peut subsister au profit d’actionnaires ayant perdu cette qualité. La Cour de cassation française a déclaré que « l’existence d’un droit d’agir en justice s’apprécie à la demande introductive en justice et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures ». Il s’agit en l’espèce d’un arrêt de censure d’un arrêt d’appel qui a jugé irrecevable une demande d’expertise de gestion présentée par un actionnaire détenteur de 20% des actions composant le capital social mais qui, en cours d’instance, ne justifie pas de la qualité d’actionnaire par suite des résolutions de l’assemblée générale décidant l’annulation du capital social par absorption des pertes puis la recapitalisation, le demandeur n’ayant pas souscrit d’actions nouvelles dans le délai utile.
La Cour de cassation tunisienne a cependant retenu une conception stricte de l’exigence d’un intérêt actuel. Il s’agit, dans un arrêt en date du 21 octobre 1997, d’une action intentée par la locataire d’un appartement auprès de la SNIT qui en a concédé la jouissance gratuite à sa mère et son frère. À un moment, il a sollicité du tribunal d’expulser son frère. En cours de procédure, un jugement d’appel a prononcé la résiliation du bail conclu avec la SNIT de sorte que la qualité du demandeur en tant que locataire est perdue. L’action en expulsion a été jugée irrecevable.
Un autre arrêt de la Cour de cassation en date du 19 février 1987 est plus nuancé. Il s’agit d’une action en déclaration de mainlevée d’une clause de déchéance inscrite dans un contrat de vente. La clause de déchéance a une durée limitée. Un arrêt d’appel a déclaré l’action irrecevable pour défaut d’intérêt motif pris que la clause de déchéance a une durée limitée et elle s’éteint par le seul dépassement du délai. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond auraient dû vérifier s’il existe un intérêt au jugement.
Mais à supposer que le demandeur a un intérêt à agir, le juge peut-il s’immiscer dans la gestion financière et décider de son impérium de mettre à distribution des dividendes à prélever sur le bénéfice distribuable voire même des réserves disponibles ?
- II L’immixtion irrégulière du juge dans la gestion financière de la société
Le demandeur après avoir cédé ses parts sociales actionne la société émettrice pour la voir condamnée au paiement de la somme de 130.811,378 dinars représentant sa part dans les bénéfices de l’exercice 2010 et la somme de 35.652,472 dinars représentant sa part dans les bénéfices de l’exercice 2011. Ayant été débouté en première instance pour la première branche, il interjette appel. Paradoxalement, la cour d’appel lui donne satisfaction mais condamne la société au paiement de la somme de 107.841,534 dinars par prélèvement sur le bénéfice distribuable de l’exercice 2011. L’on se demande si elle n’a pas statué sur des choses non demandées. Au-delà de cette critique d’ordre procédural, le jugement d’appel est critiquable dans la conception qu’il se fait de l’office du juge dans la gestion financière de la société.
Il faut au préalable circonscrire le cadre juridique de l’affaire au fond. Il s’agit d’une action intentée par un ancien associé contre la société pour lui réclamer non le paiement des dividendes qu’elle a décidés de mettre en distribution avant sa sortie mais du paiement de sa part dans les bénéfices qu’elle a décidé de ne pas distribuer et qu’elle a reportés ainsi à nouveau.
De tels faits relèvent incontestablement du droit des sociétés commerciales et non du droit de la vente. Pour qu’il en soit autrement, il faut que le litige oppose l’acheteur à son vendeur, un litige éventuel entre eux sur leurs droits respectifs sur les dividendes ou encore un litige opposant l’administration fiscale et les parties au contrat portant sur une réclamation de supplément de cotisations au titre des droits d’enregistrement de l’acte de cession ou au titre de l’impôt sur la plus-value. En d’autres termes, pour que le droit de la vente soit applicable, il faut que le litige porte sur le contrat de cession. Or, ce n’est pas le cas ici. Il s’ensuit que la référence aux articles 609 et 610 du code des obligations et des contrats faite par le jugement commenté est hors propos. Ces articles ne sont pas applicables et ne peuvent servir de fondement à la solution du litige.
L’arrêt commenté s’est référé à l’article 140 du code des sociétés commerciales. En cela il est fondé, sauf que la cour d’appel l’a mal compris et l’a mal appliqué.
Le principal attendu de son arrêt énonce que « le résultat reporté (les bénéfices reportés) ne devient pas une partie des capitaux propres de la société dans la mesure où l’assemblée générale n’a pas décidé son incorporation au capital ; il demeure donc un droit des associés ; ils peuvent en demander la distribution en totalité ou en partie ». L’erreur est double : le résultat bénéficiaire reporté fait partie des capitaux propres de la société quand bien même il n’est pas incorporé à son capital social (a) ; par ailleurs, il est plus exact de dire que le report bénéficiaire est disponible pour les associés réunis en assemblée générale ; ce sont eux seuls qui peuvent décider sa distribution en totalité ou en partie et non le juge (b).
- Le résultat bénéficiaire reporté composante des capitaux propres de la société et disponible aux associés
Contrairement à ce qui a été énoncé par la cour d’appel, le résultat bénéficiaire reporté par délibération de l’assemblée générale ordinaire fait partie des capitaux propres de la société. La notion de capitaux propres n’est pas inconnue du droit des sociétés commerciales. Les articles 142 et 380 du code des sociétés commerciales prévoient en substance que si les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu’elle a subies, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans les deux mois de la constatation des pertes pour se prononcer, s’il y a lieu, sur la dissolution anticipée de la société.
Les articles 142 et 380 du code des sociétés commerciales sont une version moderne d’anciennes dispositions figurant au code de commerce qui énonçaient qu’en cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs ou les gérants de la société doivent consulter les associés en vue de dissoudre la société par anticipation (art.135 al. 1 et art 176 al 2 du code de commerce). C’est au contact du droit comptable que cette nouvelle rédaction du code des sociétés commerciales est rendue possible.
La notion de capitaux propres est empruntée au langage comptable et financier. La norme comptable relative aux capitaux propres (NC : 02) en donne la définition suivante : « les capitaux propres sont l’intérêt résiduel dans les actifs de l’entreprise après déduction de tous ses passifs. Ils comportent les diverses catégories de capital, les compléments d’apport, les réserves et équivalents, les résultats reportés et les résultats positifs ou négatifs ». Ladite norme comptable définit par la suite le sens de chaque notion employée.
Mais pourquoi la cour d’appel a-t-elle jugé que le report bénéficiaire ne fait pas partie des capitaux propres ? Pourquoi considère-t-elle que le report bénéficiaire ne peut devenir parmi les capitaux propres que s’il a été incorporé au capital ? En premier lieu, il semble que la cour d’appel a été victime d’un glissement sémantique entre capital social et capitaux propres. Elle trouve une équivalence dans les notions. En deuxième lieu, la cour d’appel semble s’intéresser à la disponibilité des bénéfices pour les associés. Le capital social est formé des apports des associés et il est intangible. Les associés ne peuvent réclamer son remboursement qu’à la fin de la société ce qui n’est pas le cas du report bénéficiaire. Si ce dernier est incorporé dans le capital, il sera gouverné par la règle de l’intangibilité du capital. Tant que cette incorporation n’est pas faite, il demeure disponible. C’est ce que semble dire la cour d’appel au final.
En réalité, ce n’est pas seulement le report bénéficiaire qui est disponible. Les réserves facultatives le sont également. Les associés peuvent décider une distribution des bénéfices par prélèvement sur les réserves. Cette distribution n’est pas possible quand il s’agit d’une réserve légale ou d’une réserve statutaire. Pour cette dernière, l’assemblée générale peut supprimer l’indisponibilité qui la frappe par un changement des statuts.
En réalité, le caractère disponible du report bénéficiaire n’autorise pas le juge à décider sa distribution. C’est l’assemblée générale ordinaire qui a le monopole de la décision.
- La compétence exclusive des associés à décider la distribution des dividendes par prélèvement sur le bénéfice distribuable
La cour d’appel a fait comme si le demandeur continue à être associé et a condamné la société à lui allouer une part dans le bénéfice distribuable proportionnelle à sa part dans le capital social.
Il est évident que la décision est rendue en violation de l’article 140 du code des sociétés commerciales. Un associé ne peut pas requérir du juge de se substituer à l’organe social compétent. La compétence de l’assemblée générale en la matière a pour effet d’interdire au juge de s’immiscer dans la gestion financière de la société.
Le juge intervient a posteriori pour sanctionner la délibération abusive prise par la majorité des associés dans leurs intérêts personnels et contrairement à l’intérêt social. Une fois la délibération litigieuse annulée, l’office du juge s’arrête là. Il appartient à l’organe compétent de convoquer une autre assemblée générale ordinaire et statuer une nouvelle fois sur l’affectation du bénéfice distribuable conformément à l’intérêt social.
Il faut rappeler la conception classique de l’affectation des bénéfices dans le droit des sociétés commerciales. Sous l’empire du code de commerce, l’affectation des bénéfices sociaux est une affaire des associés. L’assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice, décide également de l’affectation des bénéfices. Sous réserve de la dotation de la réserve légale ou éventuellement du respect des clauses statutaires pour la dotation d’une réserve statutaire (appelée encore extraordinaire) ou de la distribution d’un premier dividende, les associés exercent librement leur droit de vote pour décider la distribution des bénéfices ou leur dotation en fonds de réserve facultative ou simplement leur report à l’exercice suivant. Cette liberté est toutefois surveillée par le juge, qui contrôle a posteriori les abus dans l’exercice du droit de vote. Lorsque l’intervention du juge est sollicitée, et la preuve de l’abus est rapportée, la sanction est normalement l’annulation de la délibération abusive, mais cette sanction est insuffisante à satisfaire l’associé. Elle s’explique cependant par le fait qu’il est interdit au juge de s’immiscer dans la gestion sociale. Il est vrai que cette conception du rôle du juge est parfois contredite par certaines juridictions du fond. Il est arrivé, en effet, des fois où les juges condamnent la société au paiement des dividendes alors que l’assemblée générale a décidé de la dotation des bénéfices aux réserves. La pratique nous montre également que, souvent, les tribunaux sont saisis par des associés minoritaires en vue de condamner la société au paiement d’une somme d’argent au titre de leur part dans les bénéfices en l’absence de toutes délibérations des associés constatant l’existence du résultat de l’exercice. Le plus souvent, ces associés se plaignent du fait que le gérant majoritaire ne convoque pas l’assemblée générale pour présenter les comptes de l’exercice. Il lui arrive même qu’il ne tienne pas une comptabilité régulière. Les tribunaux donnent raison aux demandeurs et condamnent la société au paiement après avoir ordonné une expertise en vue de déterminer le bénéfice. De tels jugements sont critiquables car ils procèdent d’une confusion entre le dommage subi par l’associé du fait de l’abus de majorité ou la carence des gérants et le dommage subi par l’associé du fait du défaut de distribution des bénéfices. Le débiteur de l’indemnité ne devrait pas être la société, mais le groupe majoritaire ou le gérant ayant commis la faute de gestion (défaut de tenue de comptabilité). Le juge ne peut prendre la place des organes sociaux, mais il doit prendre les mesures nécessaires pour vaincre leur inertie ou annuler leurs actes irréguliers.
Cette conception classique de la compétence exclusive des associés à décider la distribution des dividendes n’est pas remise en cause par les dispositions du code des sociétés commerciales. Le droit aux dividendes ne naît pas de l’arrêté des comptes par le gérant ou de la déclaration des bénéfices faite à l’administration fiscale, mais de l’approbation des comptes par l’assemblée générale (art 1304 du COC) et la décision de distribuer des dividendes (art 140 CSC pour les SÀRL et art 275 pour les SA). «L’approbation des comptes annuels, écrit un auteur, prépare la décision de distribution qui permet ensuite de constater l’existence de sommes distribuables et d’en décider une répartition». Tant qu’une mise en distribution ne soit pas intervenue, les bénéfices appartiennent à la société. Il ne faut donc pas confondre entre deux concepts différents : les bénéfices et les dividendes. Selon un auteur « les bénéfices, qui proviennent des biens sociaux et du travail humain, appartiennent à la société ; ils consistent dans des deniers. Les dividendes sont des créances qui appartiennent aux associés et qui proviennent des droits sociaux. ». Pour les différencier, on emploie en langue arabe les expressions مرابيح et مرابيح موزعة.
La compétence de l’assemblée générale à affecter les bénéfices de l’exercice est générale quand bien même il s’agit de la dotation à la réserve légale.
Il en est de même si les statuts prévoient, pour la protection des minoritaires, la distribution d’un premier dividende (dividende statutaire), une décision de l’assemblée générale est toujours nécessaire pour les mettre en distribution. D’une manière générale, les stipulations statutaires relatives à l’affectation des bénéfices ne s’appliquent pas directement mais en vertu d’une décision de l’assemblée générale. Certes, l’assemblée générale qui ne respecte pas la clause statutaire relative à l’affectation des résultats (premier dividende ou réserves statutaires) commet une violation des statuts, mais cette violation ouvre droit à une action en nullité et ne permet pas, pour le premier dividende, une action en paiement.
L’arrêt de la cour d’appel commenté a manifestement violé l’article 140 du code des sociétés commerciales. Cet article, après avoir imposé une distribution du tiers du bénéfice tous les trois ans, énonce qu’une décision contraire peut être prise par l’assemblée générale décidée à l’unanimité des associés. Implicitement mais nécessairement, l’assemblée générale est appelée à décider la mise en distribution du tiers du bénéfice distribuable. L’article 140 CSC, tout comme une stipulation statutaire de premier dividende, limite la souveraineté de l’assemblée générale sans exclure son intervention formelle. Le droit au dividende naît à l’issue d’un processus formalisé de l’organe compétent.