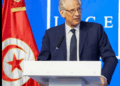En scrutant de près la liste des premiers groupes tunisiens (groupes familiaux) ainsi que la forme juridique la plus répandue au RNE (SARL et donc PME à caractère souvent familial), le constat est trivial et sans appel: le tissu économique tunisien se compose majoritairement de sociétés familiales. Il nous paraît donc judicieux de nous intéresser à ce type si particulier d’entreprises, leurs réalités tunisiennes hétérogènes, leurs défis et leurs perspectives.
En partant de sa définition, la société familiale est une structure dont le capital (ou droits de vote) est détenu majoritairement par une seule famille restreinte ou étendue (ou plusieurs dans des cas plus rares). Sa particularité est différenciée essentiellement par trois caractéristiques principales: d’abord, la propriété et le contrôle par la famille, ensuite l’implication directe (à des degrés différents) des membres de la famille dans la stratégie et la gestion opérationnelle et, enfin, la transmission de l’entreprise à travers les générations. En Tunisie, indépendamment de leurs tailles, les sociétés familiales vivent des réalités très différentes, de par leurs modes de gestion, la nature de leur gouvernance, leurs problématiques et leurs performances. Ces réalités pourraient être classées en 3 univers parallèles distincts:
1/ Les sociétés à gestion «patriarcale»
Souvent des SARL, le capital est détenu à 100% par la famille, où généralement le père (qui est aussi le gérant) possède la majorité des parts et distribue quelques parts à sa femme et à ses enfants. Le gérant pratique généralement du «bricolage managérial», que ce soit au niveau de la gestion opérationnelle ou au niveau des process juridiques (AG, cession de parts…), accaparant à lui seul le pouvoir de tous les organes de gestion. Ces structures souffrent dans la plupart des cas de mauvaise gestion, de coûts fixes importants, de structure financière déséquilibrée qui résultent en des problèmes structurels de trésorerie qui vont jusqu’à menacer la viabilité et la pérennité de la structure, ce qui cause la disparition chaque année de plusieurs dizaines d’entités similaires.
Pour ce groupe d’entreprises familiales, le gérant historique n’ayant pas pu assurer la création de richesse à même de garantir la croissance nécessaire, les solutions les plus efficaces sont souvent les plus radicales en matière de financement, nécessitant généralement un effort salvateur d’injection de liquidités par augmentation de capital, si des perspectives de croissance intrinsèque subsistent, ou si l’entreprise profite encore d’une position avantageuse et historique sur son marché. Le «patriarche» devrait par ailleurs commencer à songer à l’intégration progressive et graduelle de la 2e génération et l’impliquer dans le plan de redressement et de restructuration 360° de l’entreprise afin de préserver sa pérennité et de pouvoir migrer à moyen/long terme vers le 2e univers.
2/ Les sociétés de structure intermédiaire
Malgré une ouverture limitée du capital à des tierces parties, le capital reste majoritairement détenu par la famille, toujours directement impliquée dans la gestion de ce type d’entreprises (SA ou SARL). Là, il y a des tentatives d’instauration des bonnes pratiques de gestion, les organes de gestion (CA, CS ou CODIR) existent réellement mais leur rôle reste formel en matière de suivi et de cadrage stratégique. Ce type concerne la majorité des PME, dont les problématiques peuvent se résumer essentiellement à une organisation interne défectueuse ou non optimale, et à un manque d’accompagnement bancaire au niveau de leurs financements. Cela est souvent reflété par une croissance qui stagne, des marges de plus en plus serrées et une force de vente ne voulant pas sortir de sa zone de confort.
La réponse à ces défis passe notamment par une ouverture plus prononcée à son environnement. En effet, le gestionnaire ne devrait pas hésiter à mandater des cabinets externes pour des missions de diagnostic, d’audit et de conseil, à renforcer davantage le rôle des partenaires en repensant sa relation avec ses banques et en alternant les mandats de ses commissaires aux comptes pour avoir constamment un œil critique externe. Pour le cas des groupes familiaux, une recherche de synergies entre les sociétés afin d’optimiser coûts et fiscalité est une démarche souvent fructueuse et même salvatrice dans certains cas.
Il faudrait également anticiper la transition générationnelle d’une manière réfléchie et fluide afin de pallier les complications d’ordre fiscal, juridique et organisationnel. Par ailleurs, un effort crucial est à fournir au niveau de la stratégie RH afin d’attirer les compétences à tous les niveaux de la hiérarchie et de savoir les retenir en évitant les conflits que ce soit avec les plus anciens salariés, résistant le plus au souffle du changement ou avec les membres de la famille historiquement impliqués ou nouvellement intégrés dans la structure.
3/ Les structures familiales avancées
Ce sont généralement des sociétés anonymes avec un contrôle plus dilué de la famille au niveau du capital, où celle-ci reste impliquée directement ou indirectement dans la gestion (postes de direction générale, présidence du conseil d’administration…) mais plus rigoureusement supervisée par des organes de surveillance clairement définis à cet effet.
Malgré des dizaines de success stories, une nette solidité financière et des structures en apparence saines, ces entités ont des défis majeurs en matière de stratégie, de gestion des risques (vu la taille), ou encore de conduite du changement notamment dans la mise en place des projets transversaux de digitalisation.
Dans ce 3e univers beaucoup plus avancé, structuré et performant, la clarté de la vision stratégique est primordiale dans la mesure où à ce niveau il est souvent question de démarches complexes de diversification, d’intégration en amont/aval ou de fusion-acquisition. Enfin, une attention particulière devrait être donnée à la motivation des dirigeants pour s’assurer de l’alignement des objectifs opérationnels sur la stratégie dessinée par les actionnaires.
N’oublions pas enfin que parallèlement à cette réalité tunisienne, les sociétés familiales demeurent les sociétés qui dominent largement l’économie mondiale (L’Oréal, LVMH et tant d’autres) comme c’est la cas pour les groupes privés dominant l’économie nationale, et que malgré les défis majeurs auxquels fait face la société familiale tunisienne, quel que soit l’univers auquel elle appartient, elle est pour l’économie ce que représente la famille pour la société: le socle dont dépend étroitement la construction de son avenir.
Yassine Ben Abdallah