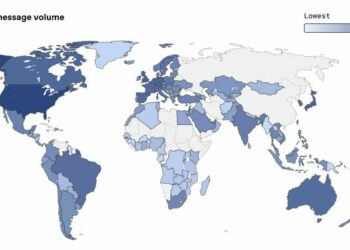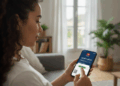Le développement d’un enseignement supérieur de qualité, qu’il soit public ou privé, est une condition indispensable pour un vrai développement durable. Mais pour que ça se concrétise, il faut deux conditions : l’investissement de l’État et l’évolution du modèle social.
Prenons le processus de choix du couple université/spécialité d’un bachelier tunisien issu d’une famille à revenu moyen. Est-ce que sa décision finale reflète sincèrement sa volonté ? Rarement. C’est d’abord une affaire où les parties prenantes (la famille essentiellement) sont très actives. Parmi les facteurs qui pèsent, il y a la composante financière avec des parents qui préfèrent généralement une université proche de sorte à réduire le coût des études.
Industrie de production de chômeurs
Il y a aussi la composante employabilité de la filière et si le score du nouvel étudiant est modeste et que l’accès aux spécialités « nobles » est verrouillé, c’est plutôt une affectation à une faculté qui n’a rien à voir avec les attentes du candidat.
À l’autre bout du spectre, il y a les bacheliers aisés. Si l’un d’entre eux veut devenir médecin, il peut l’être même avec des performances très moyennes. Il suffit de s’acquitter des frais d’études dans un pays de l’Europe de l’Est. S’il veut devenir un ingénieur, l’offre est abondante et il peut l’être avec un cycle intégré sans passer par le fameux concours des écoles préparatoires. Les résultats de cet exercice qui se répète annuellement sont visibles : des diplômés exceptionnellement prêts pour le marché de l’emploi. La démotivation les accompagne dès le premier pas à l’université et le manque de discipline n’aide pas à avoir un produit fini de bonne qualité. Une partie trouve un poste, une minorité se lance dans l’entrepreneuriat et le reste passe au chômage. La gratuité de l’enseignement supérieur et le mécanisme d’orientation universitaire en place, basé sur le mérite, n’aboutissent pas nécessairement à un système équitable car on peut être excellent, mais pauvre.
7 900 dinars par étudiant et par an
L’enseignement supérieur coûte à nous tous. En 2020, le budget du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s’élève à 1,817 milliard de dinars et ce montant serait peu affecté par la crise de la COVID-19 puisque les dépenses d’investissement ne dépassent pas 25,270 millions de dinars. Le coût annuel moyen d’un étudiant dans les structures publiques est de 7 900 dinars. Il est 8,5 fois plus faible que celui d’un étudiant dans une grande école française qui coûte 21 000 euros. Un enseignement efficace nécessite des dépenses en équipements, laboratoires, matériel technique et surtout des enseignants de premier rang. Nous ne mettons pas en doute la qualité de nos professeurs, mais ils ont eux aussi des formations continues et des perspectives de carrière pour s’impliquer davantage dans leur mission. Est-ce que nous pouvons briser ce cercle vicieux qui ne fait que tuer l’espoir de la jeunesse ?
Oui, mais c’est au prix d’une rupture totale avec le système actuel. Ce n’est pas le fait de subventionner l’enseignement supérieur qui est critiqué, mais le sens de l’irresponsabilité qu’il crée inconsciemment. Les étudiants ne comprennent pas le prix que le pays paie pour leur offrir un banc dans une université. Pour une grande majorité d’entre eux, il n’y a aucune chance pour décrocher un travail stable et n’ont aucune ambition entrepreneuriale. L’absence du love money lors de la phase de lancement d’un projet est un handicap alors que ce n’est pas nécessairement vrai.
Payer, en partie, sa formation
Le premier axe de changement est la responsabilisation de l’étudiant. Aux USA, le pays où l’entrepreneuriat est la règle, l’étudiant s’endette, en son propre nom, pour payer ses études. L’accès à l’université n’est pas basé sur l’orientation, mais sur des épreuves écrites, des concours sur dossier et parfois des tests psychotechniques. C’est vrai que c’est un fardeau pour les étudiants qui commenceront de la sorte leurs vies actives avec un fardeau de dette, mais cela les pousse à s’intéresser beaucoup plus à la formation qu’ils suivent et à intégrer le marché de travail dès la première occasion. Si nous faisons payer, à travers un système de crédits, une partie des frais d’études aux tunisiens, ce comportement de nonchalance diminuera et le chômage baissera. Les exigences du premier poste seront revues à la baisse car plusieurs jeunes refusent les petits salaires de débutants. S’ils sont dans l’obligation d’avoir un revenu, ils accepteraient même de prendre le risque d’entreprendre.
Nous devons également changer de mentalité, et délaisser le modèle de « parents poules » qui accompagnent étroitement leurs enfants jusqu’à un âge avancé. Il faut leur faire comprendre qu’ils doivent prendre les règnes de leur avenir qui ne dépend que de leurs choix.
Le rôle des fondations
Et si je suis brillant mais je n’ai pas les moyens ? Là, c’est le rôle des fondations, publiques ou privées, qui prennent en charge les bacheliers ou les étudiants brillants pour continuer leurs études dans les meilleures universités. Traditionnellement, ces fondations proposent un financement pour les étudiants qui sont évalués en fonction de plans d’études ou de carrière réfléchis et cohérents, de leurs centres d’intérêt et de leur potentiel de réussite. Une partie de ces frais sont remboursés plus tard lorsque les bénéficiaires accèdent au marché de travail, ce qui permet à d’autres de bénéficier du même système. Ne s’agit-il pas d’un système plus équitable et qui offre la chance, à chacun, de faire la spécialité dont il rêve ? Il permet aussi de donner une dynamique inédite au marché de travail. Le déblocage de ce pays ne se ferait que par la résolution de la question du chômage qui reste le principal problème. Si les responsables ne sont pas conscients de cela, c’est qu’ils n’ont rien compris.