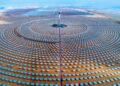Sans surprise, Moody’s a dégradé la notation souveraine de la Tunisie. Passer de « B3 » à « Caa1 » ne reflète pas un changement profond dans l’appréciation du risque tunisien. Nous étions déjà un pays hautement spéculatif et il suffit de regarder le rendement de nos Eurobonds, qui est à deux chiffres, pour conclure que ce mouvement est déjà pris en considération par les marchés.
Le plus important à analyser est les conséquences de cette dégradation qui diffèrent d’un opérateur à l’autre.
L’Etat, et pour être intellectuellement honnête, ne pouvait pas s’endetter sur les marchés internationaux bien avant cet événement et préalablement au 25 juillet. Le coût de la dette aurait été exorbitant et aucun gouvernement n’aurait pris le risque d’une telle opération politiquement suicidaire. La seule possibilité est d’aller chercher une garantie auprès d’un grand pays ami, ce qui permettra de bénéficier d’un taux acceptable.
Maintenant, l’Etat n’a pas le choix : il faut aller dans des négociations rudes avec le FMI et lancer le chantier des réformes douloureuses. Sinon, sauf miracle, nous serons en défaut de paiement en 2022. Pour les entreprises publiques, c’est plus difficile. Déjà, notre notoriété auprès des fournisseurs mondiaux n’est pas nickel, et cette dégradation va rendre les conditions de financement des opérations d’importation encore plus compliquées. Cela annonce des problèmes potentiels pour certaines matières premières et produits comme les médicaments à titre d’exemple. La BCT aura la lourde mission de gérer le peu de réserves de change pour l’allouer aux besoins urgents et vitaux, afin de préserver les équilibres sociaux fragiles.
Idem pour les entreprises privées. Les plus grandes auraient moins de soucis car elles sont rodées et leurs historiques et volumes d’opérations avec les fournisseurs étrangers devraient leur faciliter la vie. Par contre, pour les plus petites ou celles qui veulent se lancer dans cette aventure d’importations, il est fort probable qu’elles rencontrent des obstacles. Les conditions de financement seront difficiles car le coût de l’assurance est insupportable pour les fournisseurs étrangers.
Mais le vrai coût qui est oublié par la majorité des intervenants sera observé sur les chiffres de l’investissement étranger. Pour quelqu’un qui investit dans un pays, le premier souci est de ne pas perdre à cause du taux de change et le second est de pouvoir récupérer facilement ses dividendes. Ces deux conditions ne sont plus là. Si la BCT a pu encadrer l’activité des salles de marchés par des réglementations claires et que les marchés internationaux n’ont pas montré de volatilité particulière cette année, les investisseurs vont tenir sérieusement compte des scénarii de défaut de paiement, et donc d’une chute du dinar. Les difficultés d’accéder aux financements externes vont rendre les opérations de rapatriement de gains plus lentes car il y a des priorités nationales, ce qui décourage les fonds étrangers à venir.
Le prix de cette dégradation à moyen terme est lourd : moins de postes d’emploi, une moindre qualité de vie et plein de concessions à faire par la population. Le moment est venu pour affronter les conséquences de nos mauvais choix depuis une décennie.